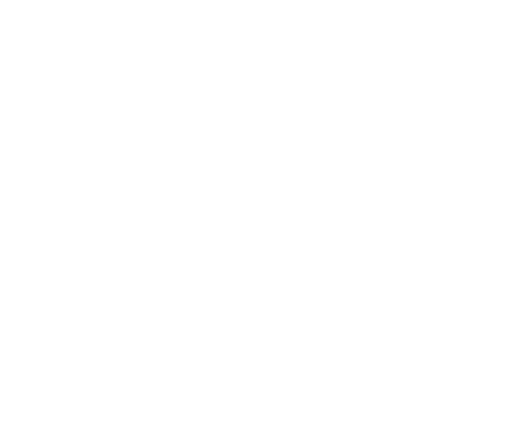Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
Mulhouse construit l’Europe des « musiques improvisées »
JAZZ (de nos envoyés spéciaux à Mulhouse). Dans la fin de l’été, une petite équipe de dix-huit personnes porte avec générosité le festival Jazz à Mulhouse, l’une des rares manifestations consacrées aux musiques européennes durant l’été. LIBRES, sauvages, diversifiées, les musiques de Mulhouse viennent en partie du free, qu’elles prolongent, étudient, continuent d’inventer comme le free prolongeait les origines du jazz. DU 19 AOUT AU 3 SEPTEMBRE, Jazz à Mulhouse a accueilli toutes les langues de l’Europe, étape d’un réseau actif, au public souvent jeune et curieux. L’UN DES MOMENTS clés de Jazz à Mulhouse, où se sont retrouvés les créateurs français d’aujourd’hui (Marc Ducret, Louis Sclavis, Claude Barthélemy…) aura été la présence du saxophoniste allemand Peter Brötzmann, dont les déferlements joyeux embrasent le jazz européen depuis bientôt trente ans.
TENTEZ LE COUP. Ouvrez la boîte à gifles sur le jazz, ouvrez-la dans l’autobus, au mariage d’une nièce, en assemblée générale. A moins de le faire aux Etats-Unis d’Amérique, vous ne trouverez plus personne à ne pas aimer le jazz. Tout le monde aime le jazz. Principe d’or. Dès les premiers noms propres (Claude Bolling, Wynton Marsalis, Jean-Michel Jarre, Enzo Enzo) les choses deviennent complexes. Mais enfin, pas de grande épistémologie sans houle de fond. Quoi qu’il en soit, les expériences de psychologie élémentaire sont formelles : dans les sept minutes qui suivent l’ouverture dudit débat, un intervenant résume la situation. Il aime tout le jazz (les Haricots rouges, Glenn Miller…) tout sauf le free ! C’est pratiquement toujours un homme qui klaxonne cet axiome. L’homme a toujours cette charge douloureuse d’endosser l’idiotie.
Les « musiques improvisées » sont comme analysées par le free d’où elles proviennent. Elles sortent du jazz par amour du jazz. Elles sont très répandues en Europe occidentale et ont servi de jonction (souvent politique) avec l’Est. Nulle trace en Espagne. L’impasse sanglante du franquisme a fait directement plonger dans un rock violent et un post-punk qui en tient lieu. Ces musiques auraient donc à voir avec le politique ? Scoop de polichinelle ! Les autres aussi, mais elles le cachent. Les « free music » ne sont pas que de la musique. Elles supposent une attitude. Le jazz a fait ses révolutions sur cet axe. Le bop (années 40, Charlie Parker) et le free (années 60, Ornette Coleman) sont des mouvements insurrectionnels : contre la reprise, le répertoire, la récupération, et l’assignation faite au jazz de n’être que du « jazz ».
Ornette Coleman, Eric Dolphy, Don Cherry et Cecil Taylor ont ouvert le feu. Mingus et Coltrane avaient servi de détonateurs. Toutes les voies sont là. La révolution free est réappropriation de la musique par les musiciens. Le bop avait déjà désiré le faire (Parker, Gillespie, Kenny Clarke, Thelonious Monk). Rien à être si vite digéré qu’une esthétique de rupture, regardez la peinture. Rien à être si vite dénié qu’un travail de mémoire, de radicalisme et d’explosion. Dans la lutte, on ne laisse rien tomber. Si vous voulez du propret rationnel, il faut changer de cap. Le renversement du bop est l’acte de reconnaissance envers le fondateur historique, Armstrong.
RÉVOLUTION CULTURELLE
Le renversement du free marque l’indépassable de Charlie Parker. Activées par les vagues de fond des années 60 et 70, en Europe, les nouvelles musiques sont la traduction la plus originale de cette révolution culturelle. Evan Parker, Derek Bailey, Paul Rutherford (Angleterre), Han Bennink, Maarten Aaltena (Pays Bas), Mangelsdorff, Von Schlippenbach, Peter Brötzmann (Allemagne), Gaslini, Rava (Italie), Fred Van Hove (Belgique), Portal, Tusques, Thollot (France) sont les grands défricheurs de ces mouvements en désordre qui ont leurs communautés (Willem Breuker), leurs francs-tireurs, leurs grands solitaires, leurs transversaux et évidemment leurs propres marginaux.
Le Français Jac Berrocal a ainsi enregistré une petite fable, Rock and Roll station, en 1976, récitée par Vince Taylor, rock-star, sur deux notes de Pierre Bastien (contrebasse) et rumeurs de pédalier, de sonnette et de chaîne de bicyclette (Berrocal). Autre remarque : ces musiques autonomes sont évidemment des lieux de réinvestissement : par les femmes, par exemple, Irène Schweizer, Joëlle Léandre, Annick Nozati…
Non, vous ne les avez jamais entendus à la radio (encore qu’avec France-Culture et France-Musique, tout soit possible), jamais à TF 1, jamais en grande surface, jamais en ascenseur, jamais chez vos amis, même les plus branchés (Carmina burana, Barbara Hendricks chante Duke Ellington, Phil Glass et ses rythmes, etc.). Sont-ce donc des musiques impassables ? Certainement pas ! C’est plus simple.
Si l’on veut recourir à une allégorie, on dira ceci. Il se trouve en Suisse alémanique un village d’opérette, terriblement helvète, tricoté de géraniums, de barrières rouge et blanc repeintes tous les mardis, de pelouses taillées au coupe-ongles, de vaches au brushing entretenu et aux cloches imposantes comme des chaudrons. Ce village sonore et ravissant s’appelle Willisau. Depuis vingt ans, un graphiste natif du lieu, Niklaus Troxler, organise le festival le plus ahurissant, pour deux mille paysans sincères et de vieilles gens proprets à qui personne n’a osé dire que le jazz « ce n’était pas ça » et que « ça », ce n’était pas de la musique. Vingt ans qu’ils suivent sans barguigner les exploits les plus stridents des énergumènes de la planète. Vingt ans de désordres et de tours de force iconoclastes. Vingt ans qu’ils applaudissent à tout rompre. L’Histoire aurait pu passer par là. Tout est possible, tout est question d’idée, tout retourne au hasard mais n’en vient jamais. En France, Le Mans, Assier, Cluny, Vandoeuvre-lès-Nancy, Prade-les-Lez et Mulhouse évidemment, ont la même politique et le même succès. Sans volontarisme ni arrogance. C’est un style de vie. Uzeste évidemment fait figure d’utopie directrice, peut-être parce qu’il y a à sa tête un énorme et incontestable musicien, Bernard Lubat. Plus ce courage de penser en occitan dans le texte : « Je ne veux pas finir comme un couillon du jazz. »
ATTENTION, VIRAGE
En effet. La question est là. La folie du jazz est de se croire musique incandescente, renouvelée, jouée demain ; groupe en fusion, insurrection réglée, musique de musiciens. Sa raison est de l’être. La question est de savoir quel musicien être dans cet impossible. La tendance régulièrement revient à l’abri, au répertoire, à l’académisme, au repli. On y nage avec un discours triomphaliste à la mesure de la peur qu’il exprime. Les musiciens, eux, savent qu’ils ont personnellement à faire au « thème », au « temps », au « bruit » et au « traitement » de l’instrument. Dans la « free music », ils ont affaire aussi, d’abord, avec l’histoire de la musique, avec leur propre histoire, avec cette sensibilité du blues, des racines et l’énergie des rythmes, la violence, qu’il faut projeter dans la pensée. On pourrait espérer le mouvement en phase terminale. Il est à craindre qu’il ne fasse que commencer.
Un soir de juillet, un homme digne dont la carrière est une suite de coups de coeur et de refus, un homme noir de Houston, Texas, qui va sur la soixantaine, un artiste qui n’a jamais gagné plus d’argent qu’un tout petit employé, et parfois moins, un maître qui a lancé sur les routes de la musique plus de musiciens réputés que cent conservatoires ne cherchez pas : son nom est Horace Tapscott était au Duc des Lombards. Le Duc, c’est aux Halles, de plain-pied, comme une brasserie ; cela n’effraie pas le profane, ce n’est pas bien cher. Horace Tapscott est un des inventeurs historiques de toute cette histoire. En 1961, il faisait bouillir la marmite au trombone chez Lionel Hampton et créait l’UGMA (Underground Musicians Association). Au Duc, plus de trente ans plus tard, avec une furia que personne ne savait, il se faisait connaître d’un public insolemment jeune. Ce fut un des plus beaux concerts de l’année. Attention, virage. L’idée de modernité n’est plus moderne (cette proposition est déjà fatiguée) et l’Europe s’ennuie. Exact ! C’est d’ailleurs très exactement ce qu’on pensait, ce qu’on écrivait, en 1967.
FRANCIS MARMANDE